Histoire et politique
Affichage de 49–60 sur 155 résultats
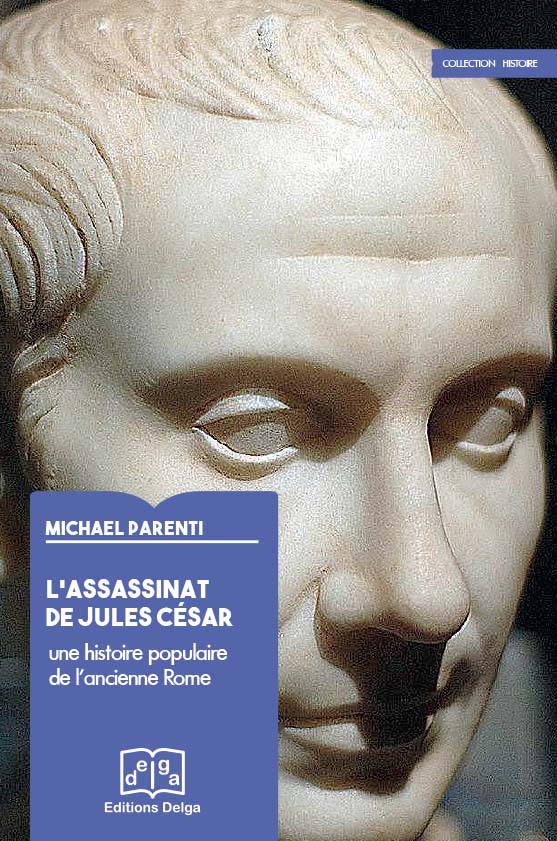
L’Assassinat de Jules César
ISBN : 978-2-37607-110-5
211 pages
19€
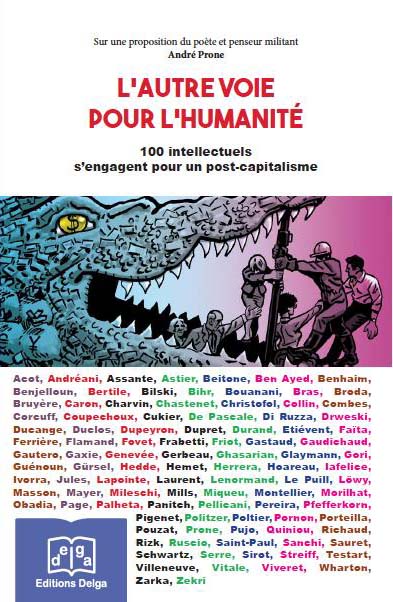
L’Autre Voie pour l’humanité
20€
ISBN : 9782376071570
391 pages
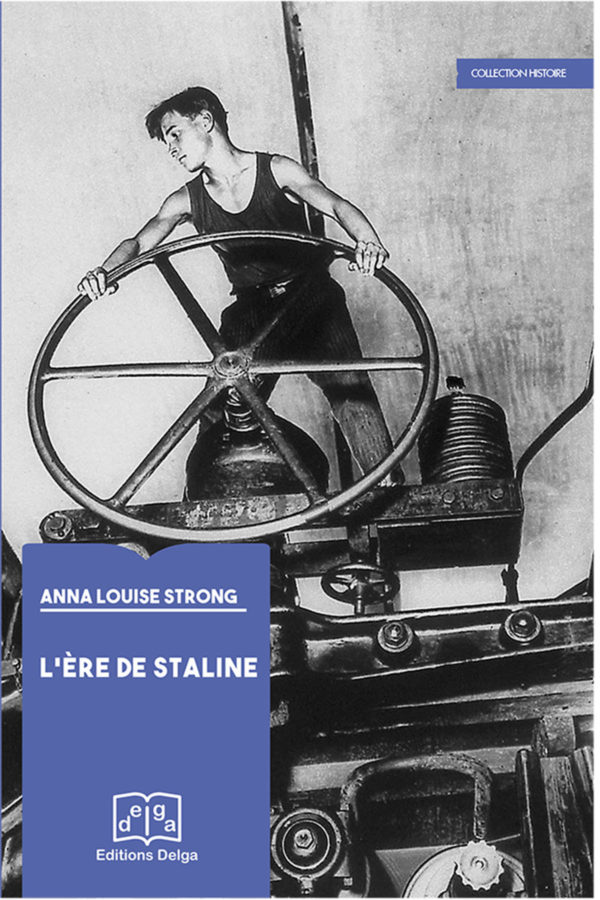
L’ère de Staline
ISBN : 978-2-915854-84-8
162 pages 17€
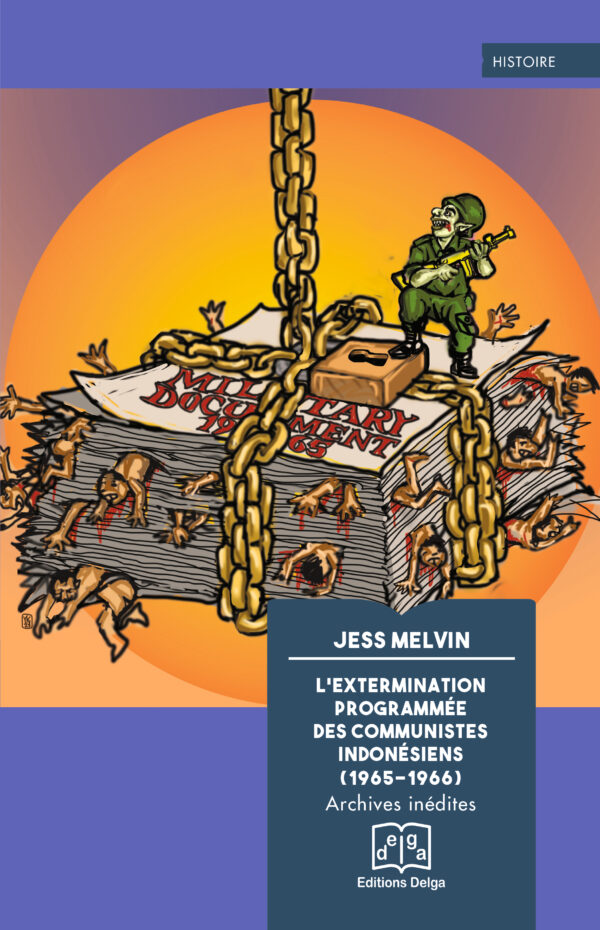
L’Extermination programmée des communistes indonésiens
ISBN 978-2-37607-248-5
445 pages

La Chine sans œillères
210 pages
SBN 978-2-37607-214-0

La Corée du Nord, cette inconnue
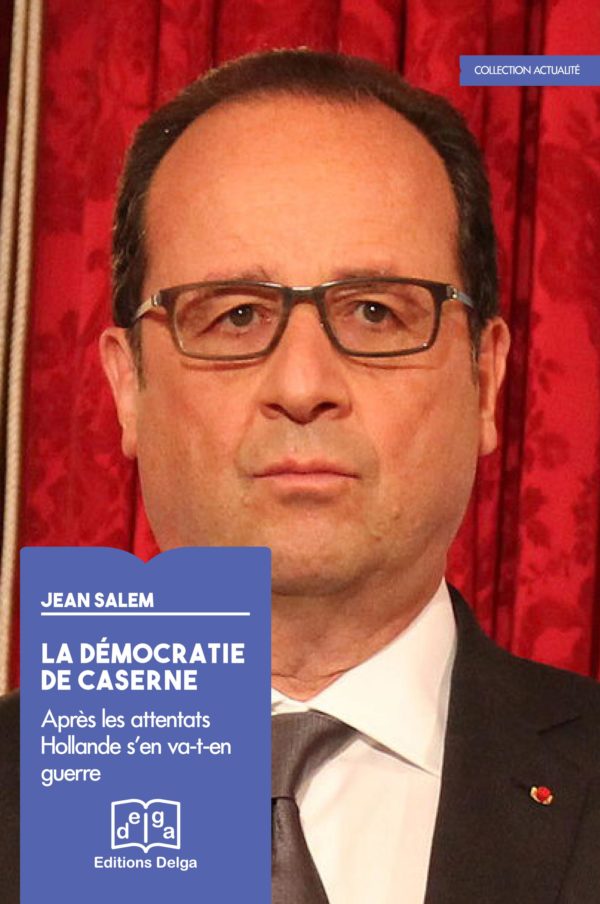
La démocratie de caserne
ISBN : 978-2-915854-90-9
70 pages
9€

La dernière république soviétique
Véritable tache aveugle de l’Europe au niveau social, le système bélarusse est un héritage direct de l’URSS : 80% de l’industrie y est la propriété de l’État et ses bénéfices sont reversés dans des caisses publiques et redistribués pour l’investissement et pour un système de protection social intégral (enseignement et santé gratuits, transports et logements subventionnés, retraite à 60 ans pour les hommes et 55 pour les femmes, etc.). Il n’y a quasiment pas de chômage (1 %), l’économie y est dynamique (croissance proche de 8 % par an entre 2000 et 2010), la main d’oeuvre hautement qualifiée, la distribution des revenus égalitaire, les oligarques inexistants, ce qui a conduit tout naturellement Loukachenko à être réélu avec des résultats d’environ 80 % à chaque élection depuis vingt-cinq ans. Cela amenait Chávez, en visite à Minsk en 2006, à dire que le Bélarus (ex-Biélorussie) offrait « un modèle de développement social que nous [Venezuela] n’avons fait que commencer à instaurer chez nous ».
Ce paradigme représente donc un défi sérieux et une menace pour l’ordre néolibéral occidental hégémonique. Ce dernier s’emploie donc à rendre suspect le processus électoral en déversant dans le grand nombre de chaînes de télévision « indépendantes » qu’il sponsorise au Bélarus un flux d’émissions hostiles au gouvernement. L’ingérence des ambassades des nations occidentales et de leur créature l’OSCE dans le processus démocratique bélarusse est par ailleurs permanent, à travers toutes formes de déstabilisations imaginables brandissant le mythe de l’absence des libertés au Bélarus, comme par exemple lors de la contre-révolution colorée « révolutionnaires en jeans » (sic) en 2006 qui fit d’ailleurs un flop... Et pour cause : tout au contraire il n’y a pas de demandeur d’asile politique bélarusse recensé dans les classements des organismes internationaux oeuvrant pour les droits de l’homme, pas d’hémorragie migratoire vers l’extérieur du pays, des référendums très fréquents, un accès universel à toutes les chaînes de télévision étrangères, etc.
Stewart Parker réunit ici de manière extrêmement salutaire, en un seul endroit, l’information nécessaire pour une évaluation authentique du Bélarus, débarrassée des contre-vérités médiatiques habituelles.
Préface de Bruno Drweski
Prix public 22 eurosISBN 978-2-37607-166-2
372 pages
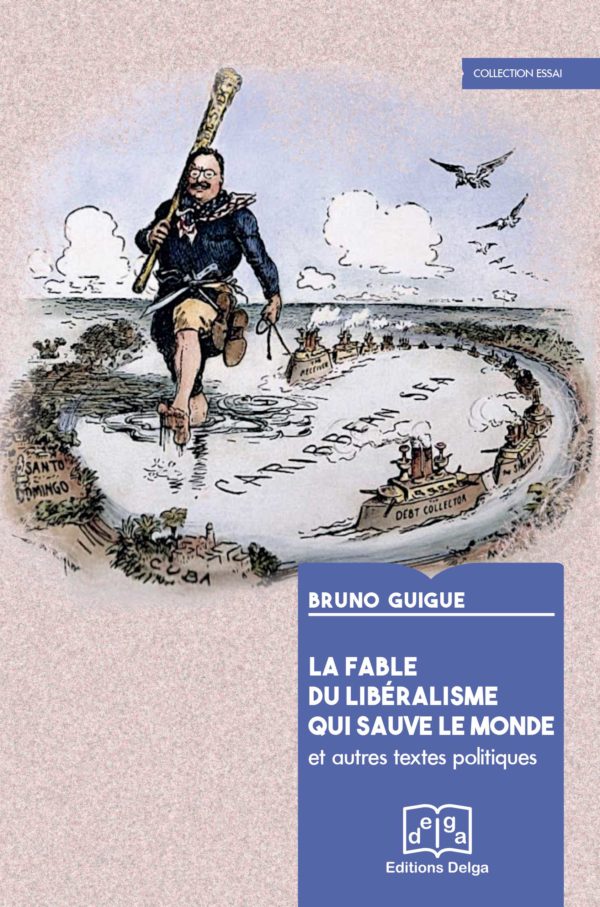
La fable du libéralisme qui sauve le monde
ISBN 978-2-37607-159-4
136 pages
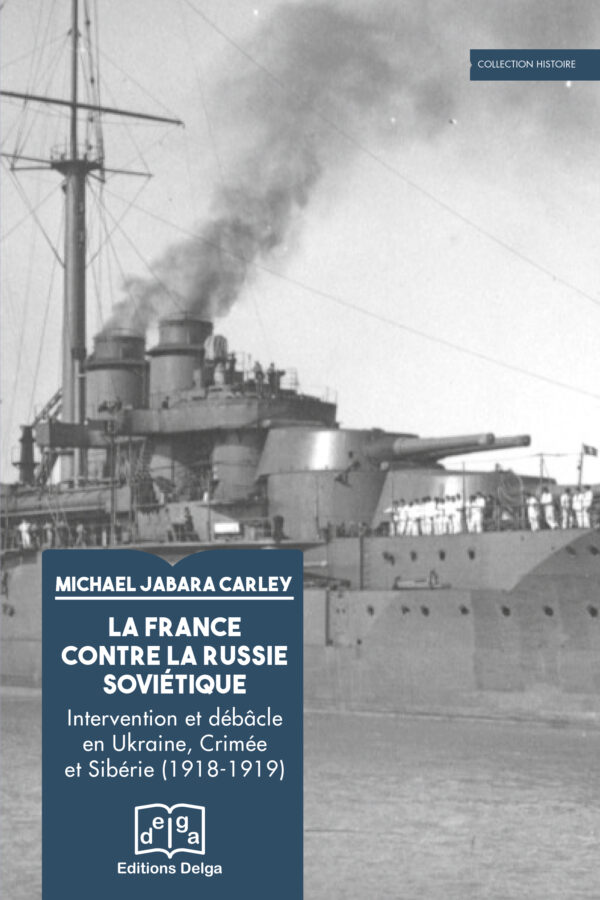
La France contre la Russie soviétique
Ces plans initiaux durent constamment être revus à la baisse (jusqu’au fiasco final après les mutineries des soldats français) du fait d’un faisceau de variables sous-estimées lors de cette intervention: absence totale de soutien à celle-ci de la population russe ; troupes françaises récalcitrantes à se faire tuer en combat- tant des prolétaires russes afin de sauver les intérêts de la bourgeoisie française, après déjà plus de quatre années de boucherie à son service ; contamination galopante de ces troupes par le bolchevisme ; opinion publique française remontée contre cette intervention juste après la dévastation de la guerre mondiale ; absence de fiabilité des troupes alliées « russes blanches » et sans base populaire, au contraire de l’Armée rouge dévouée et disciplinée.
« Il est arrivé ce qui devait arriver – l’échec complet d’une aventure ridicule. » Général P.-H. d’Anselme, commandant des troupes fran- çaises et alliées en Russie méridionale en 1919, au général Berthelot.
Michael Jabara Carley né en 1945, est professeur d’histoire à l’Université de Montréal et spécialiste des relations entre l’Union soviétique et l’Occident. Il a publié plusieurs ouvrages, traduits dans différentes langues, sur ces relations, ainsi que de très nombreux articles.ISBN 978-2-37607-262-1
398 pages
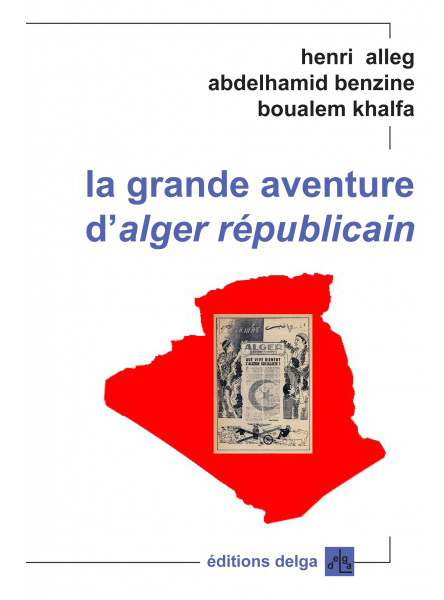
La grande aventure d’Alger Républicain
ISBN : 978-2-915854-43-5
280 pages 17€

La Grande éclaircie de la révolution culturelle chinoise
La Révolution culturelle qui s’est déroulée en Chine entre 1966 et 1976 est aujourd’hui décriée à la mesure de la chape d’ignorance qui la recouvre. Or elle est à la fois le plus grand mouvement démocratique que l’humanité ait jamais connu (et à cet égard la meilleure école quant aux capacités et aux limites de tout mouvement) et la première révolution communiste de l’histoire. Elle a mis en pratique le programme communiste de Marx, non seulement concernant la transformation de la propriété, mais aussi la réduction des grandes différences, entre ville et campagne, paysans et ouvriers, travail manuel et intellectuel, et la transformation du travail lui-même, dans sa conception et sa pratique.
Elle s’est aussi attaquée à la transformation-dépérissement de l’État, tout en prouvant et éprouvant que celle-ci dépend de l’avancée des autres points du programme communiste de Marx, autrement dit que la politique, non seulement n’est pas réductible aux questions de pouvoir et d’État, mais que les questions politiques – soit les questions du « contenu », orientation, mots d’ordre – sont prééminentes par rapport à l’État et déterminent le rapport à l’État. Ce faisant, elle a « nettoyé » les grands concepts du marxisme, depuis la notion de classe, qui fut l’enjeu de sévères discussions, de lutte de classes – pensée avant tout comme discussion au sein du peuple entre la voie capitaliste et la voie communiste, en termes d’enjeux et de mots d’ordre pratiques, ceci déterminant les questions d’affrontement et d’antagonisme, et non l’inverse –, et enfin le principal d’entre eux, celui que Marx considérait comme son apport propre, celui de dictature du prolétariat.
La Révolution culturelle a désétatisé la notion de dictature du prolétariat. Elle a mis fin une fois pour toutes (même si la marque de sa « provisoire » défaite se lit dans le retour au parti-État) à la notion d’« État de dictature du prolétariat ». Ce faisant elle a ouvert à la possibilité de sa mise en pratique, comme prise de pouvoir du peuple sur lui-même, quelle que soit son échelle, son lieu et sa durée, elle a donc ouvert à la possibilité de la politique communiste, aujourd’hui et à l’échelle du monde entier. Il y a deux voies, et pas une seule. Aux militants communistes, qui ne peuvent désormais tirer leur autorité que de leur propre décision et leur propre travail, de poursuivre et traiter ce faisant les questions en suspens.
Postface d'Alain BadiouCécile Winter
Ancien praticien hospitalier (médecine interne et maladies infectieuses) en banlieue parisienne ; militant maoïste (au sein de l’UCFML puis de l’Organisation Politique) entre 1969 et 1990. Dans ce cadre : travail ayant conduit au démarrage de la grève des foyers Sonacotra des années 70 et à la création du Comité de coordination des foyers, participation aux grèves des années 70 dans la banlieue nord, création d’un noyau politique ouvrier ; enquêtes en Lorraine sur le démantèlement de la sidérurgie ; campagne contre « l’aide au retour », mise au point du mot d’ordre « un mois par année d’ancienneté pour tout ouvrier qui quitte l’usine », campagnes à ce sujet en banlieue parisienne et dans le nord de la France, rédaction du « petit livre des ouvriers de Charleville Mézières ». En 2000, création du collectif « Sida en Afrique, la France doit fournir les traitements », dans la suite dix années d’enquête et discussions à partir du marché Château Rouge de Paris ayant donné lieu à l’écriture d’un petit journal intitulé « Pays intervention fleuve ». Rédaction (avec Olga Najgeborn et David-Emmanuel Mendes Sargo) de la brochure : « Palestiniens-Israéliens, un seul pays avec un seul État, proposition politique en sept mots d’ordre », après deux ans de travail politique collectif à Aubervilliers. Voir bibliographie en page 2.
552 pages
ISBN 978-2-37607-210-2
