Histoire et politique
Affichage de 133–144 sur 155 résultats
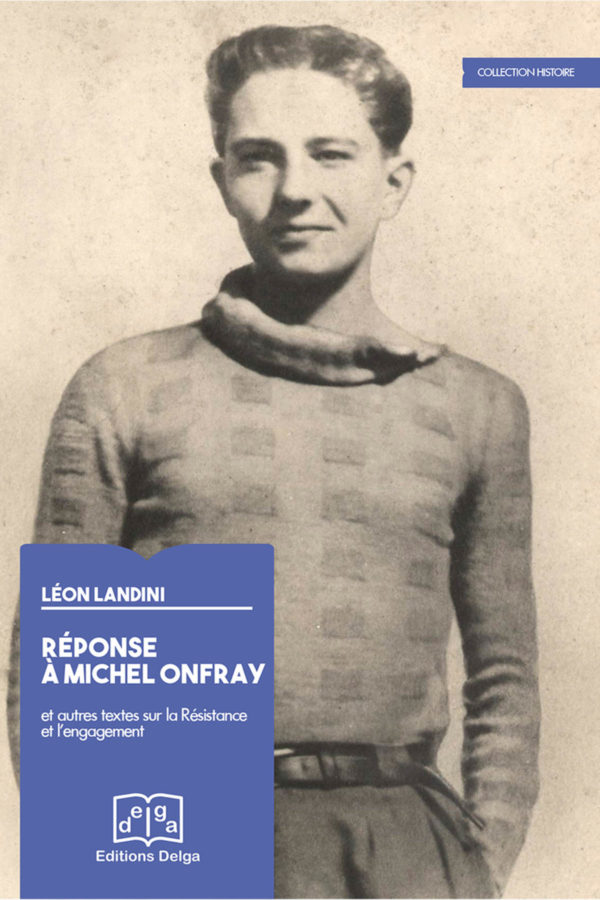
Réponse à Michel Onfray
ISBN : 978-2-915854-86-2
157 pages
15€
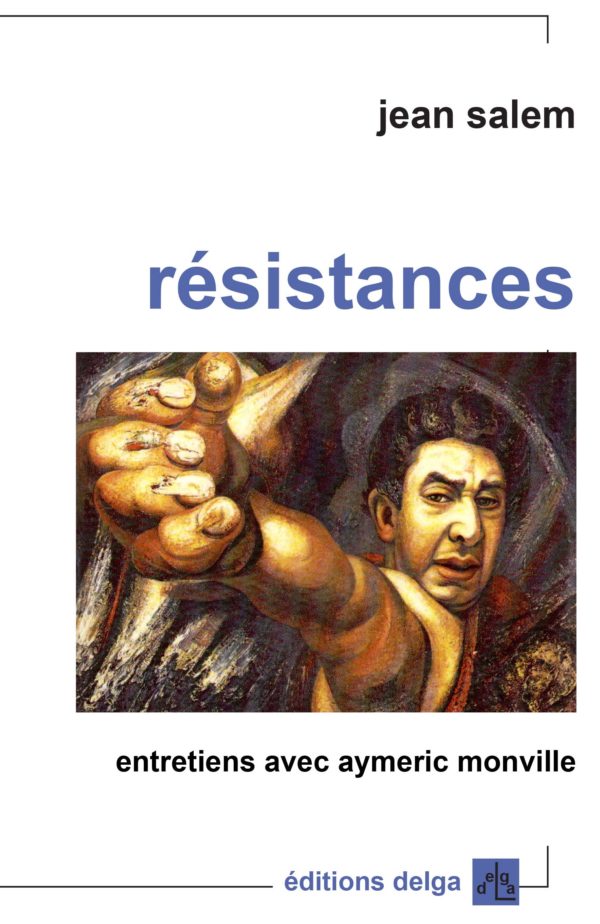
Résistances
ISBN : 978-2-915854-75-6
317 pages 20€
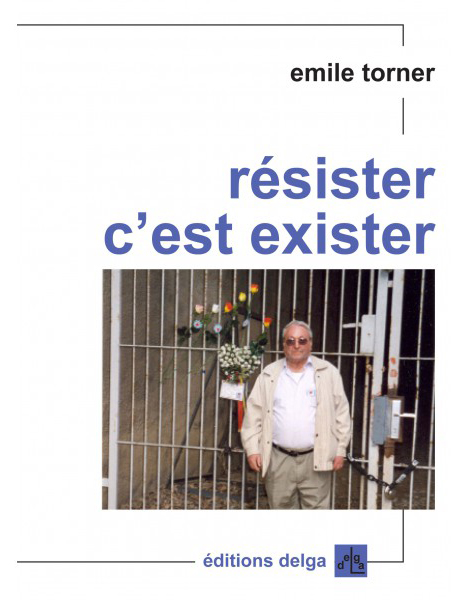
Résister, c’est exister
ISBN : 978-2-915854-22-0
135 pages 15€

Rideau de fer sur le Boul’Mich
ISBN : 978-2-915854-17-6
305 pages Format poche 12€

Robespierre à Paris
ISBN 978-2-37607-241-6
239 pages
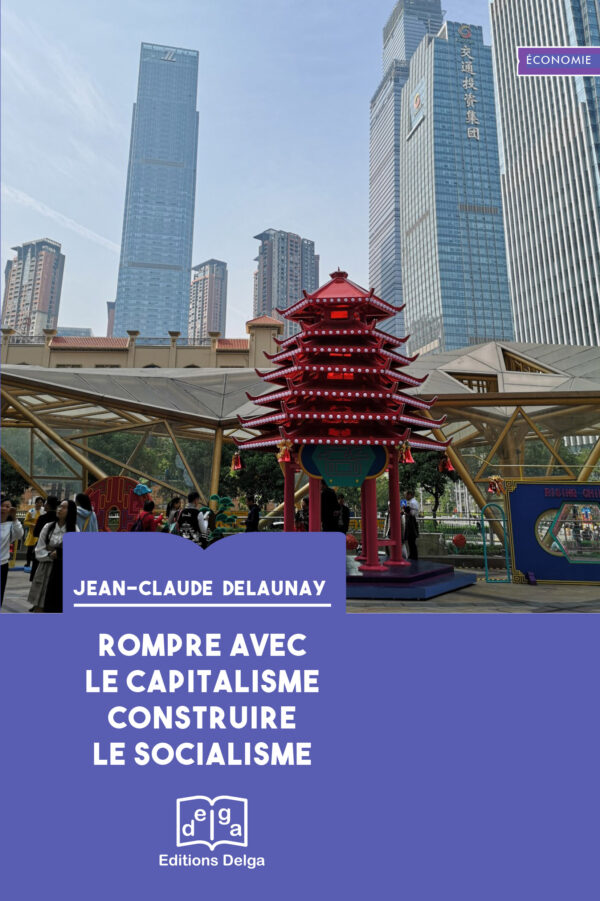
Rompre avec le capitalisme, construire le socialisme
ISBN : 9782376071914
296 pages
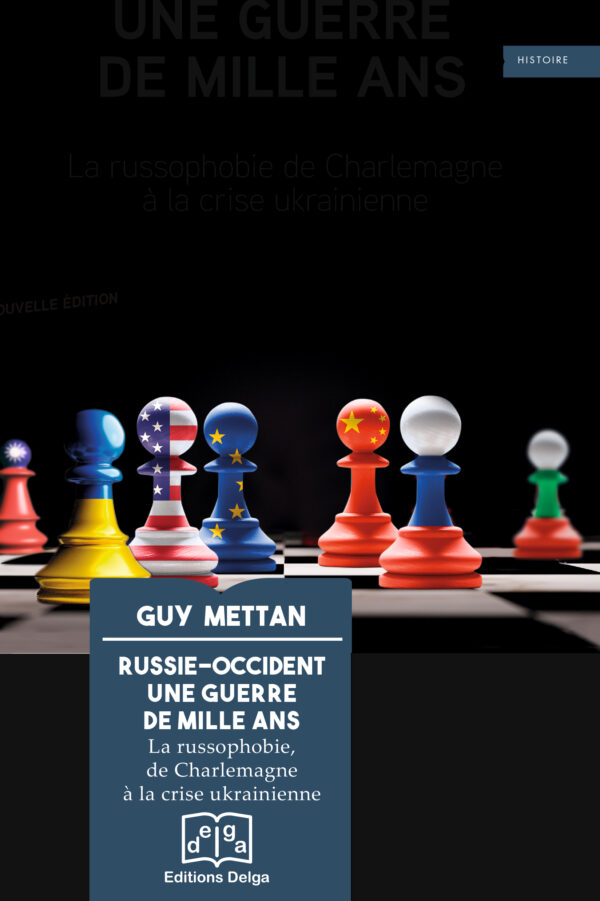
Russie-occident une guerre de mille ans
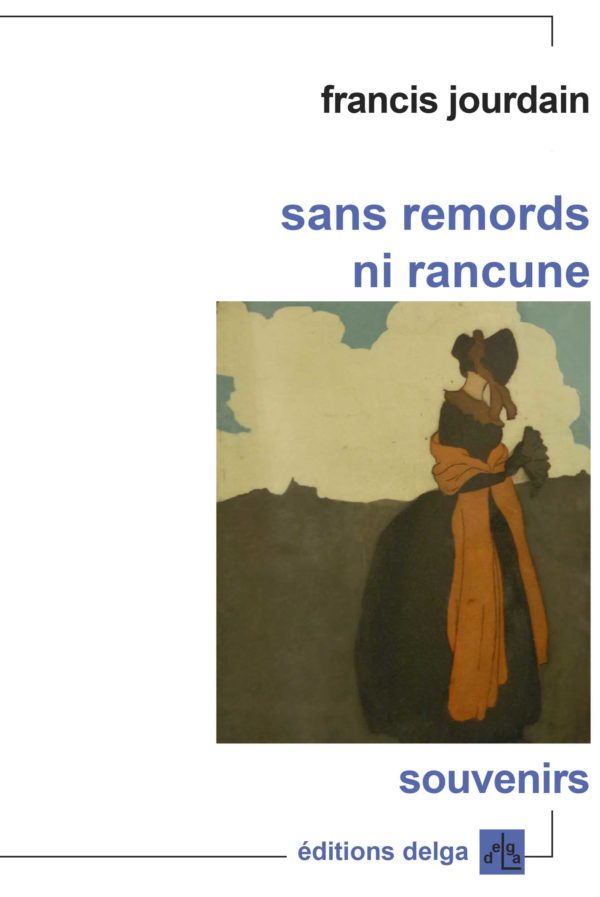
Sans remords ni rancune
ISBN : 978-2-915854-72-5
385 pages 18€
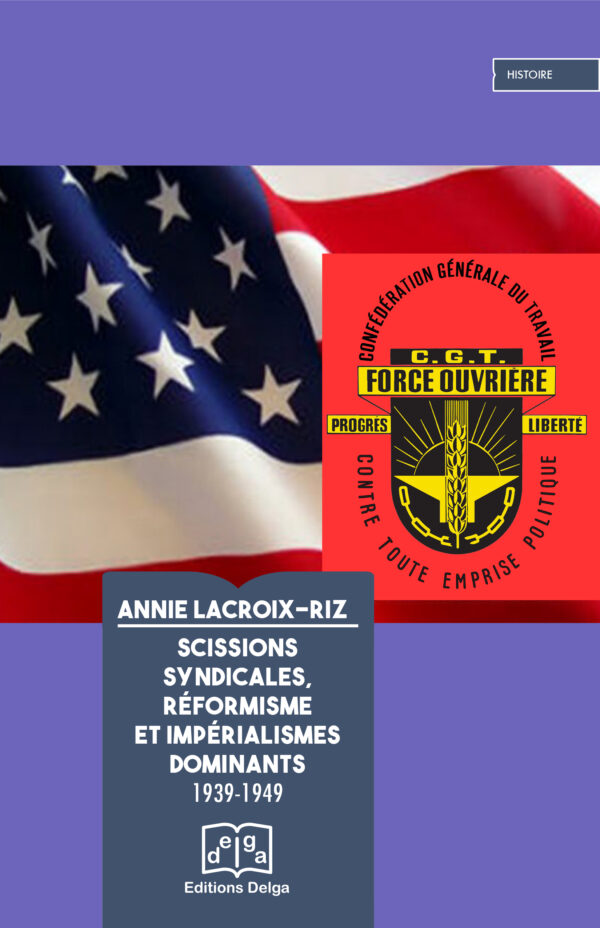
Scissions syndicales, réformisme et impérialismes dominants
ISBN : 9782376071976
335 pages
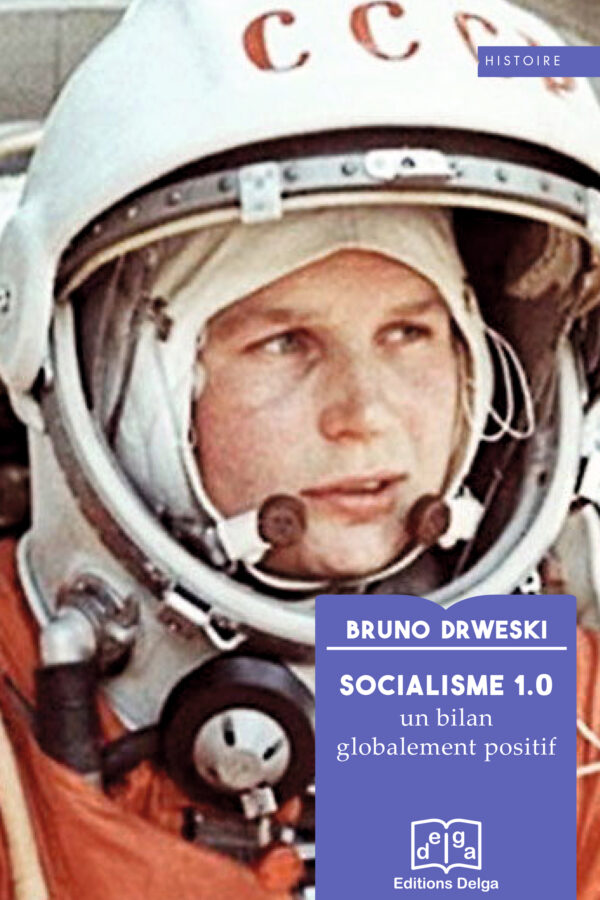
Socialisme 1.0
ISBN 978-2-37607-254-6
100 pages
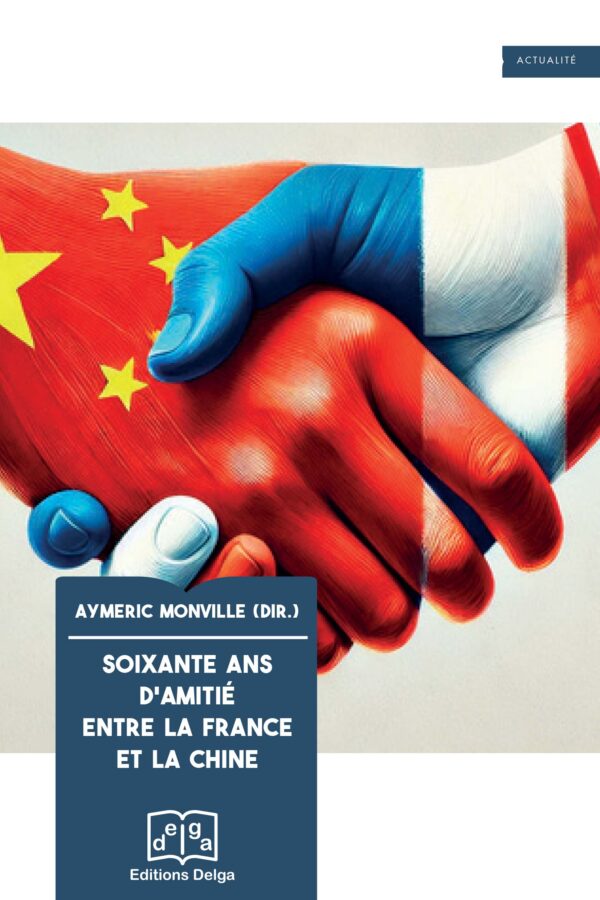
Soixante ans d’amitié entre la france et la Chine
L’année 1964 a marqué un tournant géopolitique et idéologique majeur dans le monde, lorsque la France de Charles de Gaulle reconnut officiellement la République populaire de Chine. Cet acte audacieux, porteur d’une vision historique, fut bien plus qu’une simple décision diplomatique : il incarnait une alliance implicite entre deux nations partageant une ambition commune d’émancipation nationale et de souveraineté dans un contexte mondial dominé par les logiques impérialistes des blocs.
L’année 2024 a été scandée par une série d’événements mémorables qui ont mis en lumière l’exceptionnelle solidité des relations franco-chinoises. Le soixantième anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine a été célébré avec éclat comme un moment symbolique de la longévité et de la profondeur de cette amitié. Cette célébration a permis de souligner les progrès accomplis dans des domaines aussi variés que l’économie, la culture, la science et la diplomatie, mais aussi de rappeler les valeurs communes qui unissent les deux nations.
Dans cette dynamique, l’ancien ambassadeur de Chine en France Lu Shaye, dont nous publions ici quatre discours majeurs, a joué un rôle décisif. Depuis son arrivée en 2019, il a su non seulement renforcer les liens bilatéraux, mais aussi incarner un modèle de diplomatie pragmatique et respectueuse des traditions de chaque pays. Son engagement sans faille pour promouvoir une coopération renforcée, tout en respectant les principes de non-ingérence et d’égalité, a été un atout majeur dans la consolidation de la relation franco-chinoise.
Avec les contributions de l’ancien ambassadeur de Chine en France Lu Shaye, Zheng Ruolin, chercheur à l'Institut de recherche sur la Chine de l'Université de Fudan, Jean-Pierre Page, ancien responsable du secteur international de la CGT Jean-Claude Delaunay, professeur d’économie honoraire des universités, vit aujourd’hui à Nanning (Guangxi) Bruno Guigue, ancien énarque et normalien, professeur invité à l’université à l’École de marxisme, Université normale de la Chine du Sud, Jean Pegouret, président de Saphir France et Sonia Bressler, philosophe et fondatrice de la maison d'édition La Route de la soie
ISBN 978-2-37607-272-0
175 pages
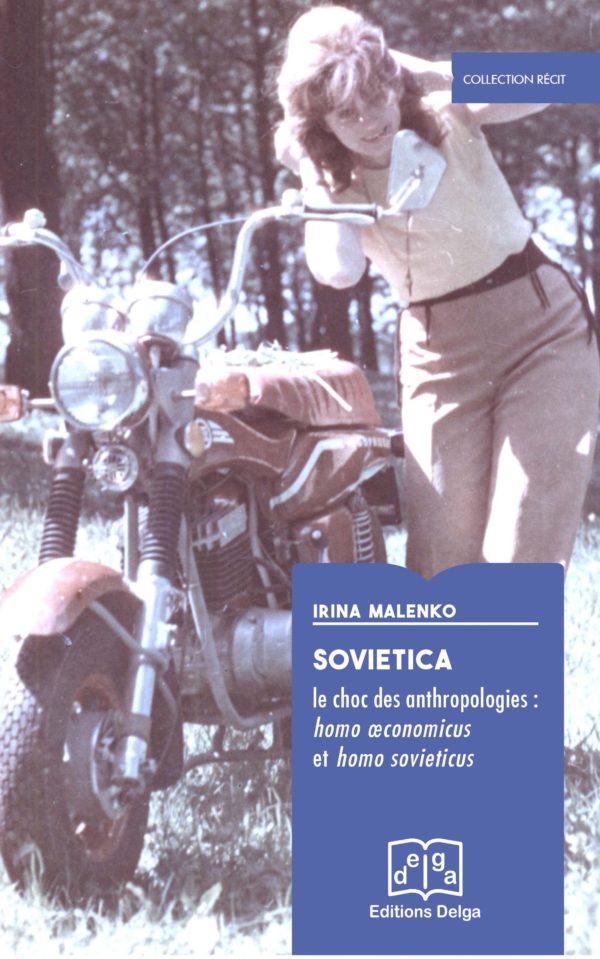
Sovietica
ISBN 978-2-37607-150-1
508 pages
